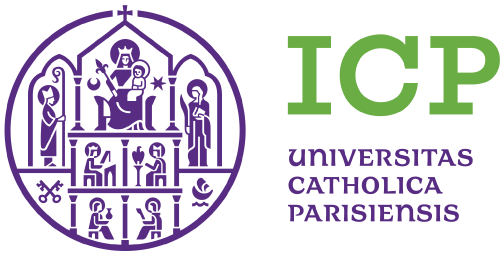"Rêver la fraternité" 60 ans de dialogue entre Juifs et Chrétiens depuis Nostra Aetate n° 4
Deux temps de réflexion, de dialogue et de rencontres à l’ICP et au Collège des Bernardins pour
célébrer les 60 ans de la déclaration Nostra Aetate, texte majeur du Concile Vatican II qui a ouvert, dans son chapitre 4, une ère nouvelle dans les
relations entre l’Église catholique et le judaïsme.
À cette occasion, l’Institut Catholique de Paris, le
Collège des Bernardins et les
Facultés Loyola Paris, en partenariat avec
KTO, se sont associés pour proposer un programme exceptionnel, qui a réuni de
grandes figures du dialogue judéo-chrétien – responsables religieux, théologiens et chercheurs – afin d’explorer ensemble :
• La réception de Nostra Aetate depuis sa promulgation ;
• Les enjeux théologiques actuels, en particulier la reconnaissance de la permanence d’Israël et ses implications pour la théologie chrétienne ;
• Les perspectives d’avenir, à travers le regard croisé de personnalités engagées dans le dialogue interreligieux.
Une soirée d’ouverture marquée par la musique, la solennité et la fraternité
Mercredi 8 octobre, la salle des Actes a retenti des harmonies d’une musique aux influences multiples pour proposer un répertoire original : celui des communautés juives d’Europe orientale, particulièrement de la Bessarabie.
Le groupe Pletzel Bandit maintient vivante cette tradition hassidique aux accents tour à tour vifs et nostalgiques.
Les prises de parole du cardinal Koch et du Grand Rabbin Korsia
Deux interventions, intenses, ont inauguré solennellement le colloque : celle du
cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et celle du
Grand Rabbin de France, Haïm Korsia. Elles ont donné le ton d’une
rencontre fraternelle et ouverte.
Le cardinal Koch a rappelé que
Nostra Aetate 4 a été
le fruit de la rencontre entre le pape Jean XXIII et le grand historien français Jules Isaac. Ce document très bref mais d’importance cruciale a tourné le dos définitivement aux siècles d’antijudaïsme catholique, affirmant que juifs et chrétiens étaient ensemble les héritiers d’un patrimoine spirituel commun. Le cardinal a terminé en disant que
Nostra Aetate constituait la
magna carta des relations entre les deux communautés.
Le rabbin Korsia, pour qui ce texte « a rendu possible l’impossible »,
a salué la volonté très forte de l’Église d’instaurer les fondements théologiques de la Fraternité, bien que, a-t-il rappelé avec humour, les frères aînés dans la Bible aient eu parfois des raisons de se méfier de leurs puînés… Pour lui, la Fraternité est « un rempart contre la perte de soi ». Et « faire vivre les possibles » exige trois conditions :
lutter contre l’antisémitisme sous ses formes contemporaines ; avancer par toutes sortes de petits pas ; lutter contre la haine envers l’état d’Israël. Au prix de cette vraie rupture, citant le Rav Kook, il a conclu : « Que l’ancien soit renouvelé et que le nouveau soit sanctifié ».
Une journée d’étude dense et riche au Collège des Bernardins
Elle a approfondi ces thématiques avec des intervenants de renom tels que Thérèse Andrevon, Olivier Rota, Mgr Étienne Vetö, Rivon Krygier, Jean-François Bensahel, Anne-Marie Reijnen, Patrice Chocholski et Luc Forestier.
Programme :
•
Réception : Thérèse Andrevon, Olivier Rota
•
Un rabbin et un évêque rêvent aux 100 ans de Nostra Aetate : Rivon Krygier, Étienne Vetö
•
Prospectives : Jean-François Bensahel, Anne-Marie Reijnen, Patrice Chocholski et Luc Forestier.
•
Des hazanim (chantres) de différentes synagogues parisiennes ont participé à l’animation et une exposition des œuvres d’Annette Bursztein sur la Torah est présentée dans la nef du Collège.
Retour sur les grandes figures qui ont façonné Nostra Aetate
Plusieurs grands thèmes ont été développés par les intervenants. Tout d’abord ont été honorés les noms des personnalités qui ont œuvré à la rédaction et à la promulgation de ce texte, louant leur détermination à ouvrir une nouvelle ère de dialogue entre juifs et chrétiens : citons
le cardinal BEA bien sûr, l’ordonnateur de cette rédaction soutenu dans un premier temps par
le pape Jean XXIII puis par son successeur
Paul VI.
Mais rien n’aurait pu se réaliser sans l’aide et l’amitié de
Jules Isaac, exigeant l’ouverture d’une nouvelle ère de relation et d’amitié entre chrétiens et juifs, avec cette conscience d’appartenir à un patrimoine spirituel commun.
Et dans les années 1980, celui qui a renforcé ce travail de dialogue entre juifs et chrétiens est
le cardinal Lustiger qui a toujours affirmé l’interdépendance entre le judaïsme et le christianisme.
Les avancées majeures du dialogue depuis 60 ans
On a rappelé le rôle et le travail du Concile qui aboutit à cette déclaration du
28 octobre 1965, Nostra Aetate, texte fondateur, premier dans l’histoire de l’Église, à définir les « relations avec les religions non-chrétiennes », et qui s’inscrit d’autre part dans le rappel de sa mission dans le monde, celle de servir et non de dominer.
« l’Église se fait dans sa relation avec l’humanité » précise Olivier Rota, et plus précisément dans le dialogue avec les autres. Tout est dans l’intention de chacun d’entrer en dialogue, dialogue de vie, dialogue spirituel, dialogue du Salut.
Depuis soixante ans, chacun a reconnu que de grandes avancées ont permis d’instaurer cette rencontre dialogale entre juifs et chrétiens, marquée par le désir de l’établir dans un climat de sérénité et aussi de lucidité. De nombreuses initiatives ont été prises :
développement des « Amitiés judéo-chrétiennes », lecture théologique avancée des grands textes juifs et chrétiens, en particulier la lecture commune de l’Ancien Testament.
Les historiens, en particulier ceux de l’Antiquité chrétienne ont contribué à mieux faire connaître l’histoire du peuple juif et des communautés chrétiennes au début de notre ère. L’
envoi par le cardinal Lustiger de séminaristes de Paris à l’université rabbinique de New-York a permis à de nombreux prêtres de recevoir une formation leur permettant de mieux comprendre le judaïsme.
Les voyages des papes en Israël, la réception d’autorités religieuses juives à Rome ont resserré les liens entre les communautés chrétiennes et juives.
Des réceptions contrastées du texte selon les régions du monde
Thérèse Andrevon a apporté cependant des nuances dans la réception du texte depuis 60 ans, selon les pays concernés.
Elle a rappelé que la situation des communautés juives peut être variable selon qu’elles habitent des pays où le christianisme est minoritaire ou majoritaire. Elle a noté également un désintérêt pour le sujet dans les mondes éloignés de la Méditerranée, comme en Asie, en Afrique subsaharienne ou en Amérique Latine.
Elle observe que la situation reste complexe dans les anciens pays communistes.
Elle a posé la question de savoir également si le mot « dialogue » avait la même résonance chez les juifs et les chrétiens, insistant sur le fait que pour les juifs, le mot dialogue se rapporte plus à la
« disputatio » du Moyen Âge, gardant le sens de controverse et non celui unique de « converser » que l’on retrouve chez les chrétiens.
Les défis contemporains : tensions géopolitiques et essoufflement du dialogue
Et s’il y a eu des avancées, plusieurs intervenants ont remarqué une sorte d’essoufflement de ce dialogue judéo-chrétien. Les raisons en sont le
changement de générations, mais surtout les
événements du 7 octobre et ceux qui ont suivi ce drame ont déplacé l’antisémitisme, l’amalgamant à un antisionisme, c’est-à-dire à la Terre d’Israël.
Et ce sujet est devenu complexe et douloureux. Comment définir cette
Terre d’Israël : en référence à la Terre biblique ? au territoire de l’État d’Israël ? à la Terre Promise, à la Terre Sainte ? La question ne peut être évoquée qu’en impliquant le politique dans la théologie. Pour
Mgr Vetö : « On ne peut pas passer des promesses bibliques à une réalité politique, il faut séparer le politique du religieux, mais distinguer sans disjoindre… ».
L’évêque de Reims rappelle que dans la théologie chrétienne,
le peuple palestinien est légitime sur la terre sainte : Abraham a partagé sa terre après l’avoir reçu, en donnant une partie à Lot. Il pose alors la question :
l’État moderne d’Israël est-il l’accomplissement messianique ?
L’apport essentiel des traditions protestantes avant et après le Concile
Soulignons l’importante contribution de la
Pasteure Anne-Marie Reijnen qui a rappelé que
Nostra Aetate n’est pas l’année zéro de la lutte contre l’antijudaïsme, il convient en effet de respecter les jalons préconciliaires du côté protestant.
Les thèses de Pomeyrol (1941) rédigées par l’Église réformée de France ont été un appui théologique à la résistance au nazisme.
La
thèse 7 fondée sur la Bible rappelle que l’Église reconnaît en Israël le peuple que Dieu a choisi. Ces thèses rejoignent le travail de
Jules Isaac et des protestants qui ont préparé la
déclaration de Seelisberg (1947).
Karl Barth, observateur protestant du concile Vatican II, l’a influencé en insistant sur la pérennité d’Israël. Il a regretté que le Décret sur l’œcuménisme n’ait pas traité du schisme entre l’Église et la Synagogue, le plus grand scandale.
Nostra Aetate « déplore » les persécutions mais ne les condamne pas. Il eut été opportun de parler de la
confession des péchés / repentance face à l’anti-judaïsme médiéval et moderne. Pour Barth, reconnaître la fidélité et l’infidélité d’Israël et celles des chrétiens permettrait le dialogue.
Renouveler le dialogue : pistes de réflexion et propositions
Que faut-il faire pour redonner une nouvelle énergie à ce dialogue ?
Thérèse Andrevon propose d’abord d’établir un « va et vient » plus approfondi entre Ancien Testament et Nouveau Testament, la liturgie chrétienne restant sur la démarche d’aller de l’Ancien vers le Nouveau.
Le Rabbin Rivon Krygier a développé ce qu’il a appelé « un rêve pour les 100 ans de Nostra Aetate ». Et pour sa démonstration, il s’est appuyé sur le songe de Jacob et sur la symbolique de l’échelle, lien entre le ciel et la terre, avec la promesse de prospérité jusqu’à la bénédiction pour toutes les nations. Pour cet intervenant, la science religieuse capte des idéaux sans expliquer le monde par le monde, mais grâce à l’esprit qui transcende les idées de son temps. Ainsi toute religion met à disposition une échelle plus haute que celles de la société, promesse de bénédiction pour toutes les nations.
Pour le Rabbin Krygier, Nostra Aetate marque une grande nouveauté : la reconnaissance par l’Église catholique des autres religions. Malheureusement, aujourd’hui, le conflit entre Israël et les Palestiniens a été récupéré par les fondamentalistes religieux (islamistes, suprématistes juifs), il est devenu religieux, et au milieu de menaces existentielles pour les deux peuples, le chrétien a un rôle à jouer, celui de passeur de paix entre ces deux communautés.
Et le texte Nostra Aetate n’est pas suffisant car il reste de nombreux préjugés entre juifs et chrétiens à combattre. Il faut travailler la Fraternité. Rivon Krygier propose des champs communs afin d’œuvrer ensemble, par exemple sur le plan artistique qui ne peut que valoriser ce cheminement du dialogue.
Mgr Etienne Vetö prolonge ce rêve par quelques propositions : entrer dans une meilleure appréhension du messianisme, réfléchir sur la compréhension commune du commandement de l’amour (Dieu unique qui nous aime), ne pas avoir peur de la réalité de l’Histoire.
Pour la pasteure A.M. Reijnen, il faudrait travailler ensemble sur l’Écriture dans l’esprit de la « mahloqet » talmudique, la controverse à partir des textes communs.
Pour le père Patrice Chocholsky, il faut ensemble retravailler la théologie du Verbe, et surtout se placer dans un « Entredeux relationnel » qui est lieu de dialogue, et considérer le Verbe comme la Parole en Acte telle qu’elle se manifeste. La Parole ne peut jaillir que d’un « entredeux dialoguiste ». Car pour lui, au « commencement est le Verbe relationnel ».
Enfin, le Rabbin Jean-François Bensahel a repris le thème de la controverse en expliquant que celle-ci ne peut être conduite que dans un esprit d’amitié et de fraternité. Il faut bâtir une relation de « connivence », en s’appuyant sur les termes hébreux : « Tu aimeras vers ton prochain ». Il a présenté trois points à travailler pour les juifs et les chrétiens :
-
Jésus est juif, « c’est un génie du judaïsme qui pratique un renouvellement du sens » ;
-
Jésus est un prophète qui annonce le royaume, il comprend qu’il est le Messie pour l’humanité ;
-
Jésus n’est pas considéré comme Messie par les Juifs ; Jésus intègre les nations dans l’histoire universelle, il ouvre les nations et les tourne vers Dieu. Il rend Dieu accessible au monde.
Compte-rendus réalisés par Catherine Marin et Ysé Tardan-Masquelier de l'Institut de Science et de Théologie des Religions
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques