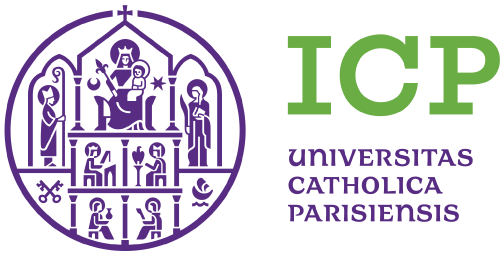« Combien j’ai aimé cette partie du monde », avait confié Agatha Christie de son vivant, dans une remémoration émue au Moyen-Orient. Née en 1890 au Royaume-Uni d’un père américain et d’une mère anglaise, c’est en 1928 que la célèbre écrivaine avait pleinement fait son entrée dans la région, au lendemain d’un divorce douloureux d’avec son premier mari, Archibald Christie, homme d’affaires et colonel dans l’armée britannique, et peu de temps après le décès de sa mère Clarissa. À bord du légendaire Orient Express, qui connectait Paris à Istanbul et lui inspirera le fameux Crime de l’Orient-Express (1934), elle voyage la même année avec pour destination finale l’Irak, alors jeune État en cours d’édification. Avant ce périple, elle avait découvert l’Égypte dès 1907.
C’est dans un Moyen Orient profondément bouleversé que le nom de la romancière a ressurgi au cœur de l’été 2025 : son ancienne demeure à Bagdad, où elle vécut treize ans entre les décennies 1930 et 1950, serait sur le point de s’effondrer. Plusieurs sources rapportent en effet que l’édifice, situé sur les rives du Tigre dans le vibrant quartier de Karadat Maryam, a cruellement besoin d’être rénové. Une situation d’autant plus critique, à en croire les passants, qu’un panneau d’avertissement « Attention ! Risque d’effondrement ! » aurait été placé sur son enceinte pour éviter que les plus curieux n’y pénètrent, et que des graffitis auraient été taggués sur ses murs extérieurs.
Une jeune aventurière en Mésopotamie
Agatha Christie n’a pas seulement vécu en Irak mais aussi parcouru un vaste territoire – de Beyrouth à Damas, d’Ankara à Téhéran –, alors que peu de femmes occidentales auraient osé y poser seules le pied à cette époque. Peu après son arrivée, elle se rend en 1930 sur un champ de fouilles archéologiques sur le site d’Ur, dans l’actuel gouvernorat de Dhi Qar, où elle fait la connaissance de celui qui deviendra son second mari, Max Mallowan, de quatorze ans son cadet.
Avec lui, elle parcourt la Mésopotamie, développant un authentique attachement au lieu et à ses habitants. Elle dira d’eux, dans son autobiographie publiée en 1946, Come, tell me how you live (en français, Dis-moi comment tu vis), qu’ils « étaient courtois, dignes et d’une gentillesse infinie. Je me sentais chez moi parmi eux comme jamais auparavant. Leur hospitalité était empreinte d’une telle grâce que chaque rencontre était comme un cadeau. »
Alors que l’Irak, qui avait été placé sous mandat britannique en 1920 par le traité de Sèvres, obtient son indépendance en 1932, l’exploratrice en herbe se rend également dans la province de Ninive. Elle mène des excavations à Nimroud, cité néo-assyrienne où elle photographie bas-reliefs et artefacts.
Agatha Christie est déjà un témoin privilégié des cycles d’une histoire qui semble se répéter, tisée d’incursions, de pillages et de violences fulgurantes. Des armées d’envahisseurs, de l’Antiquité à l’État islamique, s’y sont succédé pour profaner ses trésors, souvent dans une vertigineuse débauche de brutalité et de barbarie.
Quand la mémoire réémerge des ruines
On rapporte qu’outre sa somptueuse villa à Bagdad, l’écrivaine possédait dans ce sanctuaire du nord une autre maison en briques de terre, qui aurait été détruite quelques années avant l’assaut des djihadistes, dont les bulldozers et marteaux-piqueurs ont durablement défiguré Mossoul et ses environs en 2014.
Ceux qui la fréquentaient ont depuis disparu et les habitants locaux ne conservent d’elle qu’un vague souvenir, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement lié à son œuvre littéraire. En 2017, Abou Ammar, un villageois vivant à proximité des ruines archéologiques, déclarait ainsi à Reuters ne connaître d’elle que sa nationalité…

Il faut bien admettre que le temps s’est écoulé depuis la période mandataire et que cet Irak tant chéri a traversé maintes turpitudes dont il ne s’est pas encore tout à fait relevé. « Quel endroit magnifique c’était ! », avait pourtant écrit Agatha Christie, ajoutant que « le Tigre n’était qu’à un kilomètre et demi, et sur le grand monticule de l’Acropole, de grosses têtes assyriennes en pierre dépassaient du sol. C’était une région spectaculaire, paisible, romantique et imprégnée du passé. » Ces impressions ont été longuement relatées dans ses mémoires.
Une passion ambivalente pour Bagdad
Au-delà de sa situation personnelle, quelles raisons poussèrent donc Agatha Christie à visiter l’Irak pour y poursuivre, initialement, une épopée solitaire ? Il est question, dans l’historiographie disponible, d’un dîner en Angleterre qui l’aurait marquée car des convives y avaient décrit la grandeur de Bagdad ainsi que ses bazars pittoresques. On suppose que ces histoires, celles d’un Orient lointain et fantasmé, avaient attisé sa curiosité.
Dans ce qui deviendra son refuge, l’autrice réfléchit et écrit, rendant hommage à Bagdad mais n’hésitant pas à pointer ses travers, sans jamais succomber à un exotisme facile. Son roman Meurtre en Mésopotamie (Murder in Mesopotamia), paru en 1936, qui met en scène l’inénarrable détective belge Hercule Poirot, s’ouvre ainsi par l’évocation de « l’aspect sale et répugnant de Bagdad », ville qualifiée d’« horrible » et « loin de la féerie des Mille et Une Nuits ». Dans une narration postérieure, Rendez-vous à Bagdad (They Came to Baghdad, 1951), Christie rend en revanche un hommage appuyé à la métropole plurimillénaire.
Propriété privée ou patrimoine public ?
On comprend mieux, dès lors, les appels lancés aux autorités irakiennes pour sauver cette villa d’une fin dramatique. En mai 2025, la presse dépeignait l’impressionnante structure ottomane du bâtiment pour tenter de sensibiliser le public. De son côté, le directeur général du Conseil national des antiquités et du patrimoine, Iyad Kazem, indiquait que la demeure, bien qu’inscrite au patrimoine, était privée. Or une législation nationale de 2002 encore en vigueur dispose que des fonds publics ne peuvent être alloués à la restauration de propriétés qui n’appartiennent pas à l’État, jusqu’à ce qu’elles soient acquises par lui. Autrement dit, la maison d’Agatha Christie, connue pour son balcon plongeant sur le Tigre, ne bénéficie d’aucune réelle mesure de protection.
On rapporte qu’y a vécu de manière éphémère Ali, frère du souverain hachémite Fayçal Iᵉʳ, que les Irakiens avaient baptisé le « roi sans royaume ». Le lieu a en outre abrité l’École britannique d’archéologie, où Max Mallowan avait été nommé directeur aux côtés d’une secrétaire, de six étudiants et bien entendu de son épouse, Agatha.
La romancière adorait faire ses achats dans les souks et décorait son intérieur de tapis, d’objets en cuivre et d’antiquités. Avant que l’alerte ne soit lancée, sa maison avait été mise en vente, beaucoup craignant que des investisseurs ne finissent tout simplement par la démolir.
Un pays à la recherche du temps perdu
Comme Agatha Christie s’était rendue en Irak sur la trace d’un passé fabuleux, l’Irak continue lui-même de fouiller dans ses décombres pour en extirper une mémoire déchirée, fragmentaire, et essayer de se reconstruire. Il existe indiscutablement, derrière l’urgence du sauvetage de l’ancienne résidence de l’écrivaine, un enjeu patrimonial et mémoriel qui nous replonge dans les premières décennies de l’Irak contemporain, entre réminiscence ottomane et formation d’un État moderne et souverain.
Agatha Christie écrivit abondamment à son sujet, par touches ou de manière plus directe, et autant dire que l’Irak le lui a bien rendu. Dans La Harpe d’Agatha Christie (2016), le romancier Ibrahim Ahmad, exilé depuis la fin des années 1970, se plaît à imaginer, en langue arabe et dans une optique à la fois postcoloniale, postmoderne et biographique, la disparition de la romancière à Bagdad en 1949. En l’espèce, la fiction n’est ici qu’un prétexte à la mise en exergue de la trajectoire tourmentée de l’Irak – de sa fondation en 1921 à la séquence post-baassiste – et à l’enchevêtrement de l’existence d’Agatha Christie avec le paysage sociopolitique et culturel local.![]()
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques