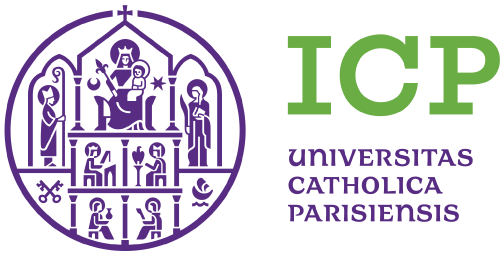L’ISTR, reconnu notamment pour l'étude du fait religieux, du dialogue interreligieux, des religions et cultures du monde, a accueilli ce nouveau spécialiste et perpétue la transmission de l'enseignement sur les spiritualités indiennes.
Nicolas Boin-Principato a pris la succession de Mme Ysé Tardan-Masquelier en assurant le cours "introduction au monde hindou" à l'ISTR.
Comment avez-vous conçu ce cours ?
Ce cours s’articule autour d’une présentation chronologique des principaux courants et mouvements ayant façonné le monde hindou.
Il débute par un rapide détour par la civilisation de l’Indus et se déploie jusqu’à l’Inde contemporaine. Nous examinons le développement de la pensée des Upaniṣads à l’époque védique, l’émergence des mythes et l’apparition du mouvement dévotionnel connu sous le nom de bhakti.
Une attention particulière est également accordée aux grandes transformations religieuses et sociales de la société indienne, notamment celles engendrées par la colonisation britannique, ainsi que les mouvements de réforme qui en découlèrent. L’étude se poursuit avec une réflexion sur les grands défis sociétaux que rencontre l’Inde d’aujourd’hui.
Le cours propose également une analyse de l’évolution de concepts fondamentaux du monde hindou tels que le dharma – souvent réduit à l’idée de « religion » –, le karma et la moksha ou « libération ».
Quel est votre parcours ?
Tout commence en 2011, lorsque
ma fascination pour l'Inde et sa philosophie naît au détour d’une conversation avec un ami d’origine indienne. Ce dernier illustrait ses propos en citant un poème du grand poète indien Kabir : « Ce ne sont pas les livres qui nous apportent la sagesse, mais la compréhension profonde de ce que signifient les deux lettres et demie qui composent le mot « amour » (prem, en hindi).
Cette façon de voir les choses me fit beaucoup réfléchir sur la dimension « pratique » de la philosophie indienne.
Séduit par la profondeur de cette « pensée indienne » et par sa dimension introspective et « pratique », je décide de me lancer dans des recherches… Je découvre, alors, la vaste littérature des textes sacrés indiens : la Bhagavad Gītā, les Upaniṣads, les Vedas, etc. et décide, au même moment, de m’initier à la méditation, au yoga.
Porté par cet élan, j’entreprends rapidement mon premier voyage en Inde…
Fort de ces premières expériences, j'entame en 2013 l'apprentissage de l'hindi à l'Inalco, tout en me plongeant dès 2014 dans l'étude du sanskrit classique à la Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Derrière ce choix, il y avait une volonté de ma part de me connecter à la culture contemporaine et de pouvoir interagir dans une (des nombreuses) langue indienne avec le peuple indien.
Pendant mes trois premières années d'études, j’effectue plusieurs séjours en Inde. J'ai ainsi l’opportunité en 2015 de suivre des cours de sanskrit avec un professeur indien de la prestigieuse Bénarès Hindu University (BHU) pendant deux mois.
En 2016,
le désir de m'immerger davantage dans la culture et la vie locale se faisait alors vivement ressentir. Je décide donc de partir en Inde pendant deux années consécutives (2016-2018) afin de suivre un cursus de Master dans une université indienne (MGAHV) située à Wardha, non loin de l’Ashram de Gandhi (Sevagram).
Ce programme d'échange universitaire me permettra d’approfondir ma connaissance de la littérature hindi, de la philosophie indienne et de la linguistique appliquée à l’hindi – et ce, entièrement en hindi, bien sûr !
De retour en France en 2018, après avoir soutenu deux mémoires, je me lance dans une thèse consacrée à l’analyse de l’œuvre de Kunwar Narain, poète et philosophe majeur de la littérature hindi.
Mon travail explore la relecture de concepts issus de la poétique sanskrite (kāvyaśāstra) dans la modernité littéraire indienne, en soulignant leur dimension sociale et humaniste. Cette réflexion a donné naissance à ce que je décris comme un « humanisme indien » qu’exprime Kunwar Narain dans son œuvre.
Enseigner, aujourd'hui, à l’Institut Catholique de Paris est pour moi
une opportunité de partager le fruit de mes recherches, en exposant les multiples dimensions de cette pensée hindoue, riche et complexe. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers Ysé Tardan-Masquelier pour m’avoir offert cette chance incroyable.
Comment avez-vous vécu cette première année avec la communauté enseignante et étudiante de l’ISTR ?
L’Institut Catholique de Paris c’est d’abord un campus magnifique… Avec le Certificat et le
DU Cultures et spiritualités d’Asie, l’ISTR propose un cursus hors du commun, un véritable dialogue interculturel, je crois pouvoir dire qu’un tel programme est
unique en France.
La diversité des profils des étudiants est ce qui fait la richesse de ce programme. Sans pré-requis de niveau, un entretien de motivation est suffisant pour intégrer le cursus. C’est une chance pour un programme d’une telle qualité car les enseignants sont des spécialistes de leur aire géographique respective. L’équipe enseignante est dynamique et à l’écoute des étudiants… j’ai trouvé à l’ISTR un climat très agréable pour travailler.
Un souhait pour l’année prochaine…
Je serais ravi de dispenser de nouveaux un cours à l’ISTR sur la Poétique indienne ancienne et moderne par exemple. Il est tout à fait possible d’envisager
une comparaison de la Poétique d’Aristote avec celle de quelques grands penseurs de la Poétique indienne. Cette dernière viendrait en complément du cours sur le monde hindou car elle est, en réalité, l’expression artistique de la pensée hindoue.
En somme, mettre davantage l’accent sur l’étude de l’Inde me semble indispensable, compte tenu de son
rôle croissant sur la scène internationale. Promouvoir une meilleure compréhension de l’autre est, en effet, essentiel pour nourrir un véritable dialogue interculturel, et c’est, je crois, la mission que s’est fixée l’ISTR.
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques