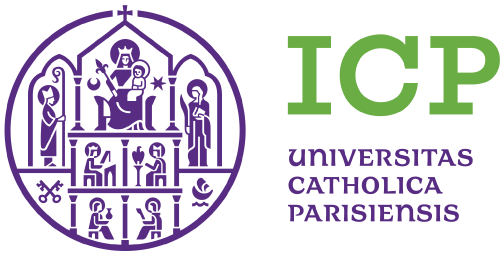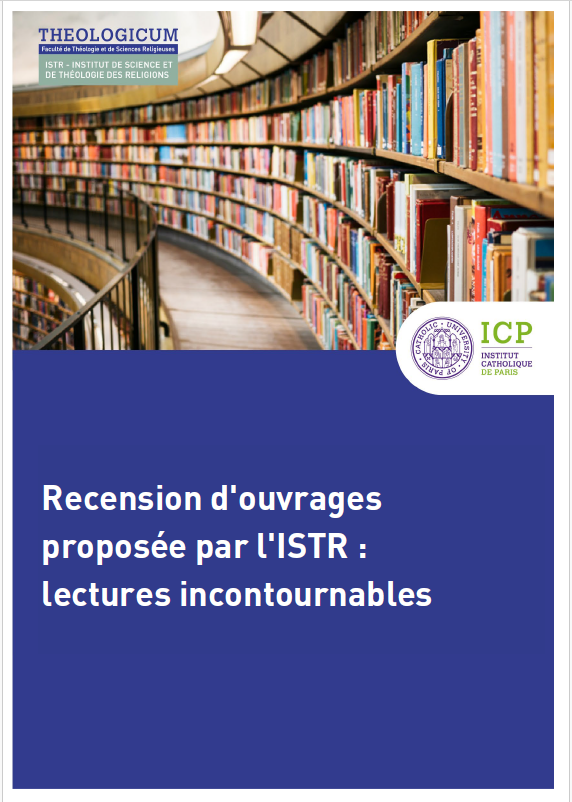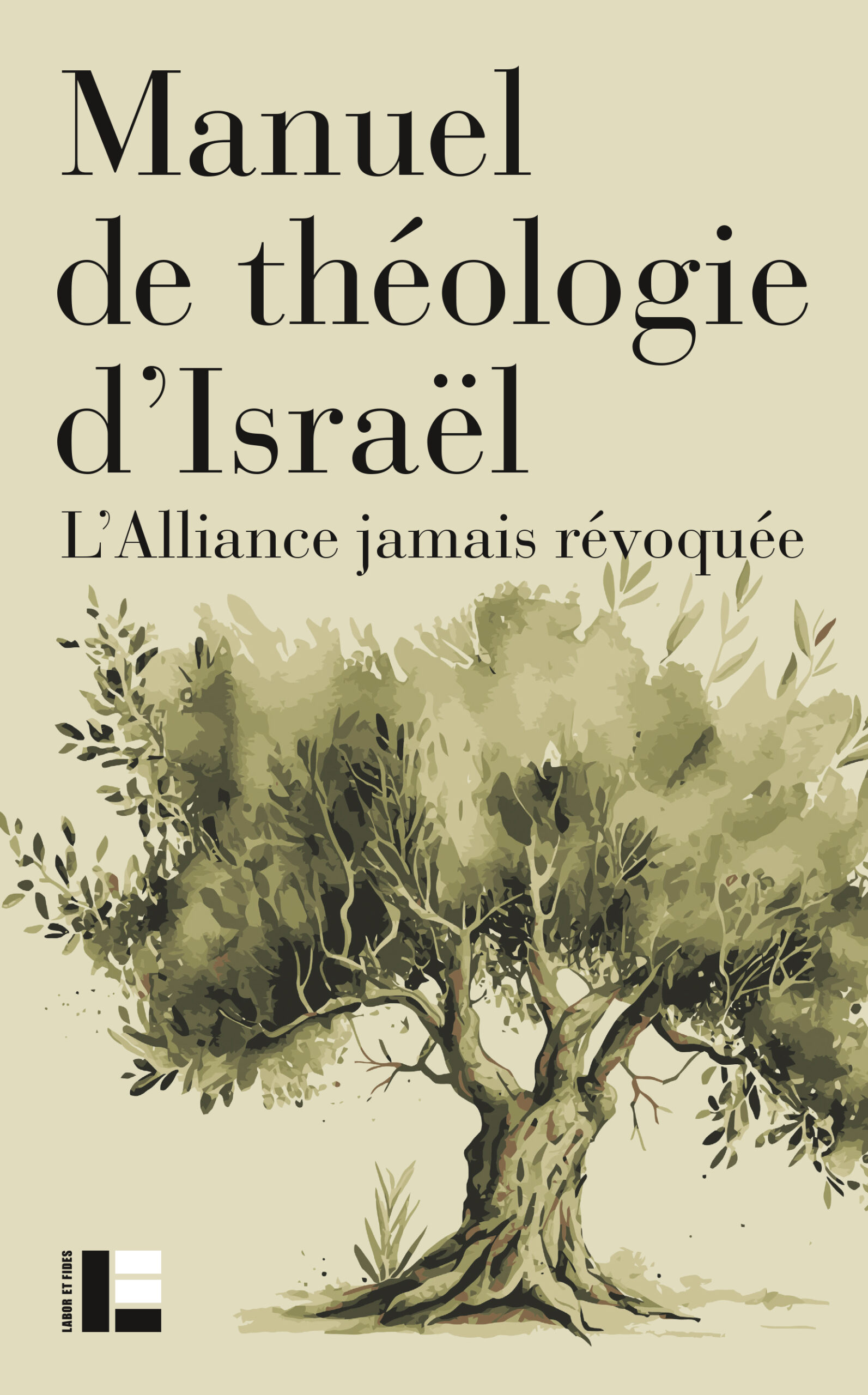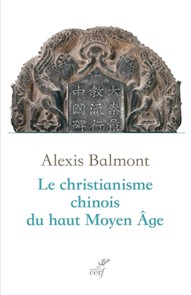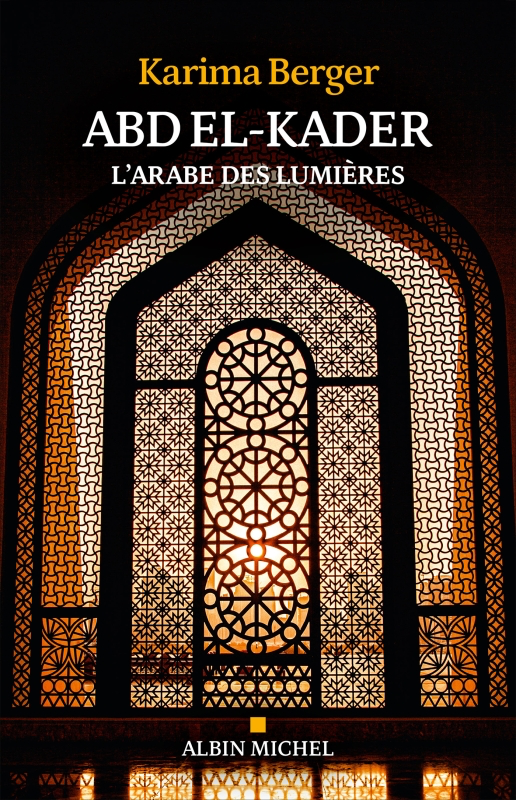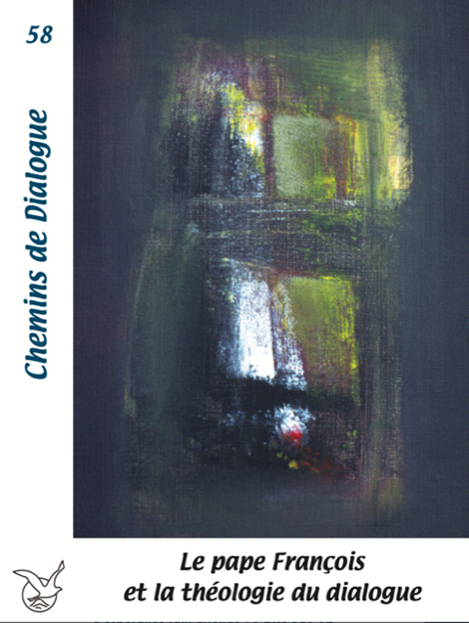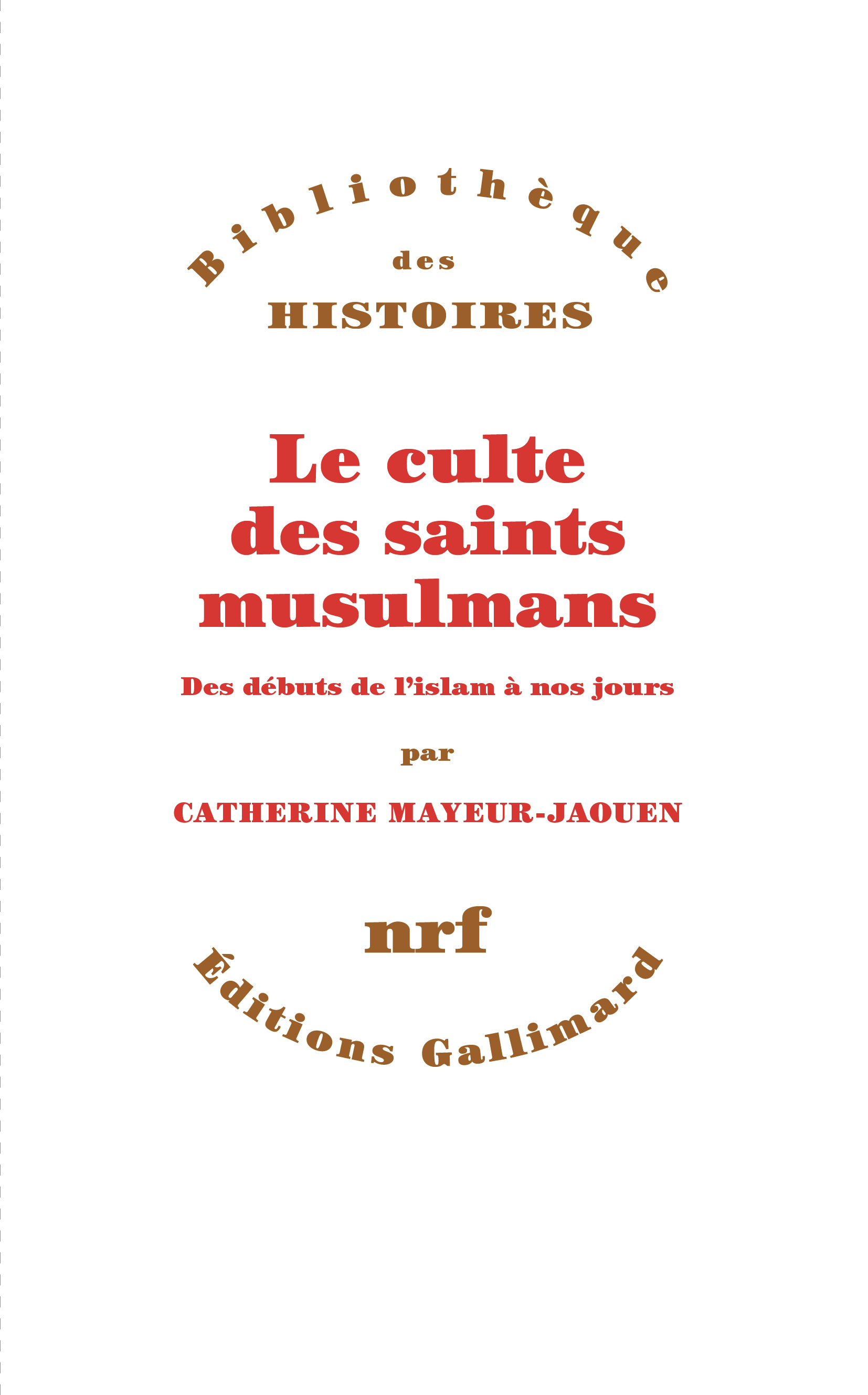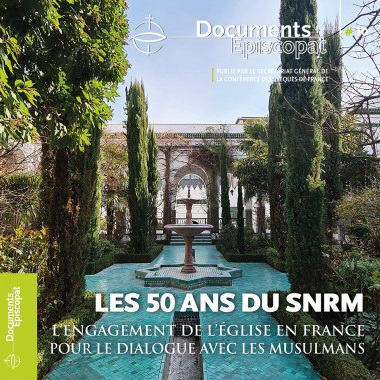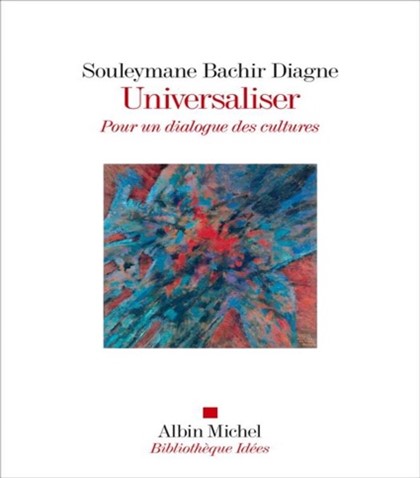Recension d'ouvrages proposée par l'ISTR : lectures incontournables
L'ISTR (Institut de Science et de Théologie des Religions) de l'ICP conseille des ouvrages qui explorent le
dialogue interreligieux à travers des perspectives variées et approfondies. Ils permettent de mieux comprendre les enjeux théologiques et culturels du dialogue entre les religions.
Manuel de théologie d’Israël. L’alliance jamais révoquée, Labor et Fides 2025
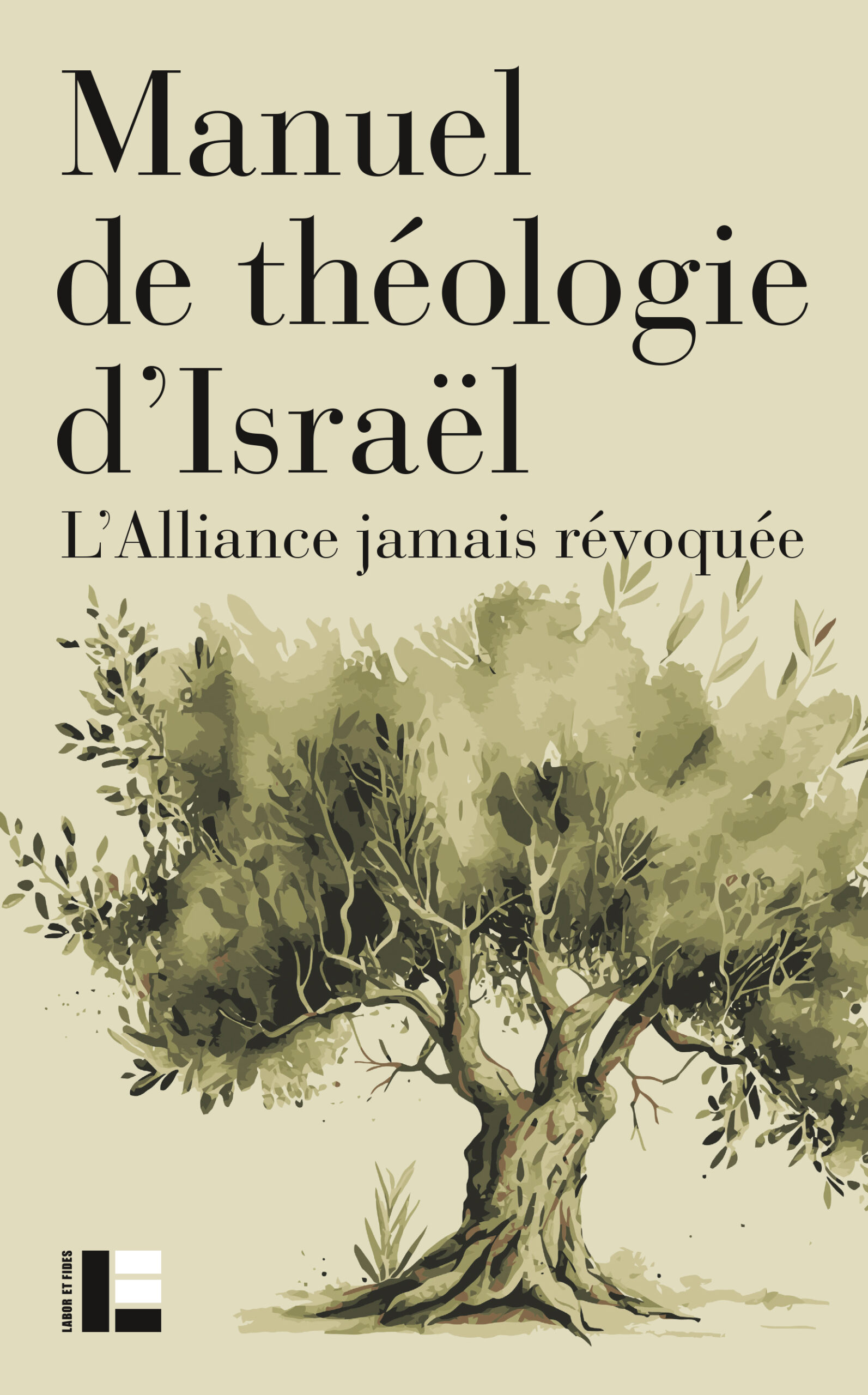 ©Les éditions Labor & Fides
©Les éditions Labor & Fides Ce manuel interroge les conséquences théologiques de l’alliance irrévocable entre Dieu et Israël. À travers des contributions chrétiennes et juives, il renouvelle l’approche des relations judéo-chrétiennes. Un ouvrage pédagogique et œcuménique pour lutter contre l’antijudaïsme.
Le christianisme au Haut Moyen Âge en Chine- Recherche historique, philologique et théologique sur les textes chrétiens chinois du VIIIe au Xe - Alexis Balmont
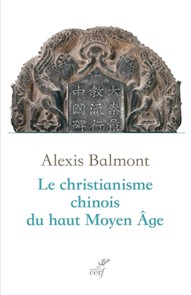 ©Les éditions Cerf
©Les éditions Cerf Une enquête historique et théologique sur les chrétiens d’Orient arrivés en Chine dès le VII
e siècle. Alexis Balmont dévoile un dialogue inédit avec la culture chinoise ancienne. L’étude repose sur une édition critique de textes méconnus et précieux. Récompensé par le prix Bellarmin pour sa contribution novatrice.
Abd El-Khader. L’arabe des lumières, Albin Michel, 2025 - Karima Berger
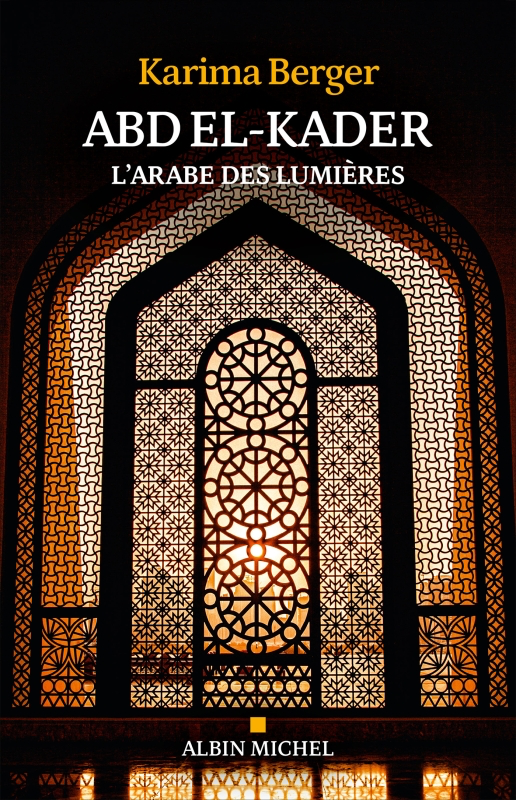 ©Albin Michel
©Albin Michel Karima Berger brosse un portrait intime de l’Émir Abd El-Kader, mystique soufi et homme de paix. Résistant, protecteur des chrétiens, admirateur des Lumières, il incarne une figure spirituelle majeure. L’ouvrage mêle biographie et méditation littéraire. Un guide lumineux pour notre temps en quête de sens.
Le Pape François et la théologie du dialogue – Chemins de Dialogue, n° 58, Marseille 2021.
La revue semestrielle
Chemins de Dialogue poursuit un travail de réflexion et d’approfondissement théologique et pastoral sur le dialogue interreligieux. Le numéro 58 sur
Le pape François et la théologie du dialogue présente un dossier recensant des extraits de discours de François (de 2017 à 2021) qui donnent d’esquisser pas à pas une théologie des religions.
Le culte des saints musulmans. Des débuts de l’islam à nos jours, Catherine Mayeur-Jaouen, Paris, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2024.
Souvent considéré comme marginal, le culte des saints musulmans est aujourd'hui un sujet brûlant, au cœur de l'histoire de l'islam, de sa culture et de son imaginaire. Raconter ce "creux le plus douloureux" des sociétés musulmanes revient à écrire l'histoire religieuse de l'islam sous un nouvel angle.
Secrétariat général de la conférence des évêques de France, Les 50 ans du SNRM. L'engagement de l'Église en France pour le dialogue avec les musulmans, Documents épiscopat, Paris, 2023.
À l’occasion du cinquantenaire de sa fondation, le Service de la Conférence des Évêques de France pour les relations avec les musulmans (SNRM) édite ce document épiscopat, qui, dans un format relativement concis (100 p.), présente l’engagement de l’Église de France dans ce dialogue sous différents angles : des témoignages, des documents et des entretiens qui donnent la parole à des acteurs du dialogue, musulmans et chrétiens, théologiens, experts, ou acteurs locaux.
Universaliser. Pour un dialogue des cultures, Souleymane Bachir Diagne, Paris, Albin Michel, 2024
Reconnaissant que « nous vivons un moment à la fois historique et philosophique, que l’on dira postcolonial ou décolonial, et qui est celui de la fin d’un certain universalisme impérial », Souleymane Bachir Diagne refuse, pour autant, de renoncer à l’universel. Et cherche à le « réinventer », car, avance-t-il, l’universel n’est pas donné une fois pour toutes. Il est à construire ensemble en reconnaissant les différences sans les hiérarchiser ni les enfermer dans des nationalismes. C’est à cette condition que l’on pourra maintenir l’idée d’une humanité commune.
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques