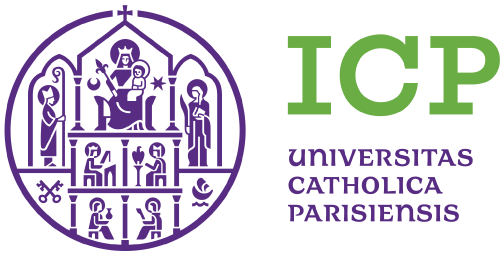Un parcours académique riche et des recherches reconnues
Ancienne élève de l’
École normale supérieure de la rue d’Ulm, Laure Solignac a soutenu en 2011 un
doctorat en philosophie médiévale à l’Université de Tours, consacré à la pensée de
Bonaventure de Bagnoregio (saint Bonaventure), figure majeure de la pensée franciscaine du XIIIᵉ siècle. Après avoir enseigné à l’université de Tours, elle rejoint l’
Institut Catholique de Paris en 2008 comme chargée de cours et y est élue maîtresse de conférences en 2012.
Au sein de la
Faculté de Philosophie,
elle a exercé diverses responsabilités – de la gestion du premier cycle, et de celle de la double licence à la direction intérimaire de la Faculté en 2020-2021 –
tout en menant une activité de recherche reconnue, rattachée à l’
Unité de recherche « Religion, Culture et Société » (EA 7403), pôle « Rationalité et Expérience », équipe « Anthropologie chrétienne ».
Ses travaux de recherche portent sur la philosophie patristique et médiévale, en particulier la pensée franciscaine du XIIIe siècle, ainsi que sur les questions anthropologiques de l’Antiquité à nos jours (notamment sur l’animalité et sur l’intelligence).
Elle est également
responsable du Réseau bonaventurien depuis 2020, lequel regroupe des chercheurs de toute nationalité, philosophes, historiens ou théologiens, travaillant sur les œuvres de Bonaventure, qui fut maître à l’Université de Paris puis successeur de François d’Assise à la tête de l’Ordre des frères mineurs.
Parmi ses dernières publications,
un article témoigne de son engagement auprès de l’
Institut d’Études médiévales de l’ICP:
« L'homme au sein de la nature et la nature en l’homme dans les premiers commentaires des Sentences », in Pascale Bermon (éd.),
La nature au Moyen Âge, Paris, Vrin, coll. « IEM », 2024, p. 161-187.
Des priorités au service des enseignants et des étudiants
Soucieuse d’équilibrer recherche, enseignement et responsabilités académiques,
la Doyenne entend favoriser un climat de travail stimulant et bienveillant pour l’ensemble des enseignants-chercheurs. «
Quand les enseignants sont heureux dans leur recherche, les étudiants le ressentent en cours », souligne-t-elle.
La proximité avec les étudiants reste également au cœur de son projet : entretiens individualisés en début d’année, suivi pédagogique attentif et accompagnement renforcé tout au long du cursus, du premier cycle jusqu’au doctorat – un accompagnement de qualité est en effet particulièrement précieux dans un contexte de croissance des effectifs.
Continuité et nouveaux projets
Dans la continuité du travail accompli par son prédécesseur
Camille Riquier, Madame Solignac souhaite
consolider les acquis et impulser de nouveaux développements pour la Faculté. Elle entend notamment
poursuivre le renforcement du master de Philosophie, dont la dynamique a permis d’ouvrir la
préparation à l’agrégation dès cette rentrée 2025.
Avec une volonté de soutenir la vie étudiante et l’engagement des jeunes chercheurs,
elle encourage également la relance de la revue « À mi-chemin », véritable espace d’expression et de valorisation des travaux étudiants.
Elle souhaite faire de la Faculté un lieu d’accueil privilégié pour les doctorants, en quête d’un établissement pour mener à bien leur thèse en philosophie, et développer des partenariats avec des institutions reconnues afin de créer des synergies académiques au service des étudiants.
Durant son mandat, elle s'attachera à
promouvoir la philosophie comme une aventure humaine et collective de recherche du vrai.
Une Faculté face aux défis contemporains
Consciente des
enjeux actuels liés à l’usage du numérique, aux écrans et aux risques de harcèlement amplifiés par les réseaux sociaux, elle défend une philosophie « les pieds sur terre » ancrée dans le réel, qui aide les étudiants à
développer leur attention, leur esprit critique et leur capacité à dialoguer.
«
La philosophie n’est pas une discipline abstraite, rappelle-t-elle. Elle permet de réfléchir à partir de notre expérience et en nous appuyant aussi sur l’expérience et la réflexion des personnes qui nous ont précédés ; elle permet de questionner nos certitudes et d’entrer dans un dialogue constructif avec les autres. Plus que jamais, elle est indispensable à la formation intellectuelle et humaine des étudiants. »
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques