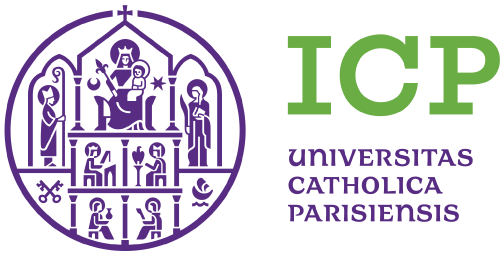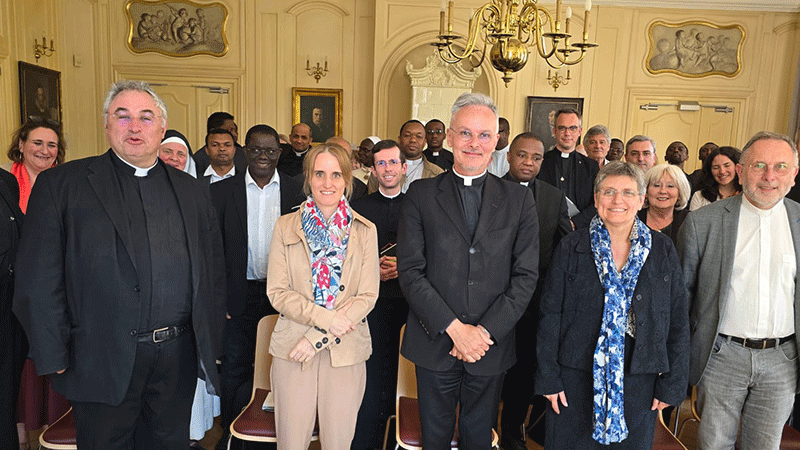Étudier la synodalité dans les traditions chrétiennes issues des Églises de la Réforme à Strasbourg, Berne et Genève
L’objectif principal de ce voyage consistait à
approfondir différents modèles de synodalité développés au sein de diverses confessions chrétiennes.
Un cycle de réflexion avait été engagé il y a deux ans à Istanbul et Athènes autour de la synodalité orthodoxe, puis poursuivi l’an dernier à Venise et Rome pour explorer la synodalité catholique, en lien avec le ministère de l’évêque de Rome.
Cette année, c'est à Strasbourg, Berne et Genève qu'étudiants et enseignants ont pu approcher la synodalité telle qu’elle est vécue dans les Églises issues de la Réforme. Strasbourg est marquée par la tradition luthérienne, tandis que Berne et Genève relèvent de l’héritage calviniste.
En intégrant des traditions diverses au sein de son parcours pédagogique, la
Faculté de Droit canonique enrichit l’approche théologique et juridique de ses étudiants, tout en affirmant sa place comme un lieu de dialogue et d’expertise sur les dynamiques synodales.
Renforcer la formation par des rencontres œcuméniques concrètes
Au total, onze conférenciers ont été rencontrés, une visite-conférence a été suivie, et quatre lieux emblématiques ont été découverts.
Ce qui a particulièrement marqué les participants, c’est l’évolution historique de la synodalité protestante, du XVIᵉ au XXIᵉ siècle.
Cette dynamique a ouvert à une réflexion sur une possible synodalité interconfessionnelle – œcuménique – au-delà des seules structures internes à chaque Église. Une telle perspective rejoint notamment l’orientation du discours du pape Léon XIV prononcé le 19 mai dernier.
 ICP
ICP La richesse des échanges conforte la position de la Faculté comme un lieu de formation qui conjugue rigueur scientifique, pertinence pastorale et actualité ecclésiale.
Approfondir la compréhension interconfessionnelle de la synodalité pour les étudiants en droit canonique
Ce voyage a permis de déconstruire certaines idées préconçues sur les autres confessions. Les conférences ont contribué à une meilleure compréhension de la synodalité dans les Églises issues de la Réforme, afin de nourrir une réflexion plus précise sur la synodalité catholique.
Il a également été acté comme une évidence que certaines problématiques, notamment sociales ou pastorales, traversent les confessions : la charité ne connaît pas de frontière confessionnelle. À ce titre, un travail commun entre Églises peut s’avérer nécessaire et, souvent, attendu. La parole du pape résonne d’ailleurs bien au-delà du cercle catholique et rejoint les préoccupations de nombreux baptisés.
Le dialogue entre les traditions est un objet d'étude à la Faculté de Droit canonique qui permet de
préparer les étudiants à penser et agir dans une Église universelle, en lien avec les réalités du terrain.
Apprendre autrement : sortir des codes pour mieux comprendre l’Église et son droit
Le droit canonique ne relève pas uniquement de la spéculation abstraite ; il s’agit également d’une
science pratique comme l’avait rappelé Benoît XVI dans son discours à l’université de la Sapienza. La pratique suppose un déplacement : une institution ne peut être pleinement comprise qu’en allant à sa rencontre.
Ainsi, l’étude du droit canonique ne peut se réduire à l’ouverture du Code ou à la répétition d’une norme nécessairement circonscrite, souvent appelée à évoluer face à des réalités nouvelles.
Par ailleurs,
un tel voyage, réunissant une cinquantaine d’étudiants et d’enseignants autour d’une problématique commune,
contribue à la constitution d’une communauté de chercheurs. Il favorise aussi une véritable cohésion facultaire, rendue possible par des échanges qu’un cadre académique ordinaire ne permettrait pas.
Ces expériences immersives
renforcent la pédagogie de la Faculté, en mettant en œuvre
une méthode d’apprentissage expérientielle faisant émerger une intelligence de terrain essentielle à la pratique du droit canonique aujourd’hui.
Accroître le rayonnement de la Faculté dans les réseaux académiques et ecclésiaux
Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Constitution apostolique
Veritatis gaudium du pape François, qui définit les piliers d’une université ecclésiastique : l’annonce kérygmatique, le dialogue, la transdisciplinarité et l’ouverture en réseau.
 ICP
ICP Les voyages d’études réalisés ces dernières années à
Rome,
Istanbul ou encore
Abou Dabi en offrent une illustration concrète.
En outre,
de tels déplacements participent au rayonnement international de la Faculté de Droit canonique et de l’Institut Catholique de Paris. Ils permettent d’établir des liens et de poser les bases de futures collaborations universitaires.
Ces voyages renforcent la visibilité de la Faculté sur la scène internationale et consolident son rôle de pôle d’expertise en droit canonique à l’échelle ecclésiale. Ils permettent aussi de développer des partenariats durables, de contribuer à la recherche collaborative.
Entretenir une culture facultaire vivante et fédératrice
Les voyages d’études font partie d'une tradition bien établie au sein de la Faculté. Le tout premier a été initié en 1984 par le doyen Passicos, et cette initiative n’a cessé depuis de se renouveler, témoignant de son intérêt et de sa fécondité.
Ces voyages permettent aux étudiants de percevoir leurs enseignants dans leur dimension humaine, en dehors du cadre strictement académique. Ils favorisent ainsi des liens interpersonnels entre le corps professoral et les étudiants, et contribuent à la construction d’une véritable cohésion de groupe.
Par cette dynamique, c’est une véritable communauté humaine qui se forme et façonne, au fil des années, l’identité même de la Faculté.
Cette tradition, toujours renouvelée, est un marqueur fort de la culture facultaire. Elle incarne la volonté de la Faculté de proposer une formation à la fois rigoureuse et fraternelle, intellectuelle et humaine, où l’expérience vécue forge une identité commune et prépare les étudiants à un engagement ecclésial profond et incarné.
 Bibliothèques
Bibliothèques
 Infos pratiques
Infos pratiques